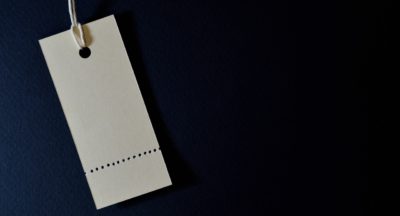Que signifie « éducation inclusive » ? Est-il paradoxal de parler d’éducation inclusive tout en parlant d’« autisme à l’école » ?
Dans cet article, nous allons expliquer les raisons pour lesquelles, de notre point de vue, il n’est pas contradictoire de faire un focus sur l’autisme tout en parlant d’éducation inclusive.
Les questions du titre sont à la fois simples et complexes, et font l’objet de nombreuses interprétations, au cœur de courants de pensée différents et parfois contradictoires. Partons de la considération qui se trouve dans le Rapport mondial de suivi sur l’éducation de 2020, qui se basant sur une réflexion formulée par le Comité des droits des personnes handicapées en 2016, dit : « l’éducation inclusive vise à assurer de manière pleine et effective l’accessibilité, la participation, l’assiduité et la réussite de tous les élèves et, plus particulièrement, de ceux qui, pour diverses raisons, vivent l’exclusion ou risquent de connaître la marginalisation ».
On constate qu’il y a dans cette citation une contradiction: la dimension inclusive équivaut à l’idée de « tous, sans exception », une vision universaliste en quelque sorte. Mais, à l’intérieur même de la citation, les auteurs identifient plus spécifiquement un groupe de personnes, celles qui « vivent l’exclusion ». C’est un paradoxe qui redimensionne la vision même d’une société inclusive telle que définie dans le rapport.
L’éducation inclusive, dit Charles Gardou, devrait être une réalité où il n’y a aucune catégorisation, ni classification, car dès lors qu’on pose une « différence », on rentre immédiatement dans un paradoxe ce qui, dans sa perspective, semble poser un problème. D’autres chercheurs prônent plutôt une éducation pour « chacun ». Le chacun rejoignant le « tous », mais en tenant compte des caractéristiques mêmes de la personne, en plus de son contexte de vie, de sa culture, de son histoire, etc.
On voit donc que la thématique de l’éducation inclusive est à la croisée de nombreuses réflexions qui s’accentuent de plus en plus aujourd’hui.

De notre côté, nous inscrivons notre réflexion en lien avec le Modèle de développement humain – Processus de production du handicap (MDH-PPH).
Nous nous inscrivons également dans la perspective ouverte par les neurosciences en lien avec l’éducation.
Mais surtout, nous nous basons sur ce que nous disent les personnes autistes elles-mêmes. Aujourd’hui il y a foison de témoignages, livres, analyses, blogs et autres ressources notamment sur les réseaux sociaux pour nous guider et il y aussi tout simplement des associations de personnes autistes qui se positionnent face à toutes ces questions sociétales. Grâce à ce dialogue on apprend à composer avec des différents styles de pensée, des sensibilités différentes et on ouvre des espaces nouveaux de compréhension et surtout de richesse que nous qualifions de interculturelle.
Dans notre vision, il n’y a pas de contradiction entre la défense d’une éducation inclusive et le fait de connaître et de tenir compte des caractéristiques personnelles d’une personne. C’est peut-être d’autant plus vrai pour les personnes autistes, qui – en parlant d’elles-mêmes- parlent d’une « condition » autistique. Elles nous disent souvent que l’autisme fait partie de leur identité. Toutefois, si cette condition explique un fonctionnement interne, elle n’est pas le seul critère qui définit leur identité. Comme pour chacun, les facteurs culturels, familiaux, mais aussi personnels (caractère, goûts, etc.) et environnementaux jouent un rôle important.
Ainsi, parler d’éducation inclusive et faire en plus un focus sur l’autisme à l’école pourra sembler contradictoire et même hérétique aux défenseurs d’une définition stricto sensu de l’éducation inclusive comme éducation pour « tous ».
De notre point de vue, en partant des témoignages des personnes autistes elles-mêmes, témoignages variés, à chaque fois uniques et singuliers, nous constatons qu’il y a un besoin d’appartenance et qu’elles identifient cette appartenance à ce qu’elles appellent leur « communauté » ou plus largement leur « culture ». L’autisme comme une autre « culture ».
Loin de vouloir enfermer quiconque derrière un « diagnostic », nous partons plutôt de cette « condition » pour aller à la rencontre de cette autre culture.
Ainsi, nous ne pensons pas que de faire un focus sur l’autisme à l’école soit contradictoire avec l’idée d’une éducation inclusive. S’intéresser à la «culture » de l’autre qui, en l’occurrence pour les personnes autistes, coïncide avec leur manière d’être, est une vision enrichie de l’éducation inclusive, où on accepte tout simplement le principe que l’autre peut nous apprendre quelque chose.
Et chacun peut être cet « autre ». Dans notre perspective, en effet, l’éducation inclusive va dans les deux sens : chacun est tantôt appreneur, tantôt apprenant.
D’ailleurs, si nous poussions le raisonnement jusqu’au bout, le fait même de dire une « école inclusive » est une contradiction. Ne devrions-nous pas dire une école tout simplement ? Mon enfant va à l’école…
Articles Similaires
Comment accompagner un.e élève autiste en classe ?
La question de l’accompagnement est importante. Parfois, on imagine qu’un.e élève...
S1, E5 – Chronique d’un petit quotidien en classe : Pierre
6 ans, quel bel âge ! Mais Pierre veut en avoir 10....
L’inclusion, un abus de langage ?
Chacun peut être parfois une partie du problème, parfois une partie de la...
Le langage oral: ces mots qui disparaissent
Un de mes élèves m'a dit un jour, à peu de choses près: “lorsque tu me parles,...